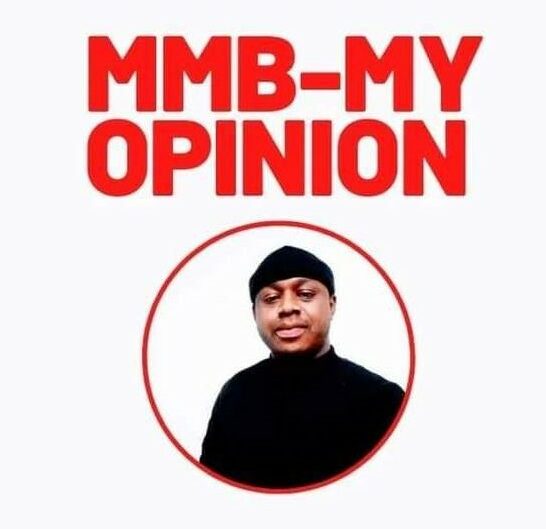La Cour Suprême de Guinée valide le scrutin du 21 septembre 2025
Un nouveau chapitre constitutionnel en Guinée : regard de juriste publiciste
Le 26 septembre 2025, dans la solennité d’une audience publique, la Cour suprême de Guinée a mis un terme au contentieux relatif au référendum constitutionnel tenu le 21 septembre. Le geste peut paraître technique, presque routinier : proclamer des résultats, valider un scrutin, rappeler l’autorité de la loi. Mais derrière l’austérité de la décision se dessine une étape décisive pour la vie politique et juridique du pays. Comme souvent en droit constitutionnel, ce n’est pas seulement le texte lu qui compte, mais l’épaisseur institutionnelle, symbolique et politique qu’il emporte.
Le juge constitutionnel guinéen, ici la Cour suprême, investie d’une compétence particulière en matière électorale a tranché. Les recours formés par deux partis d’opposition, le Bloc Libéral et le Bloc pour l’Alternance en Guinée, étaient jugés recevables: la porte procédurale n’était donc pas fermée. Cela confirme une exigence minimale de respect du contradictoire et de l’accès au juge, deux garanties fondamentales dans tout État qui se veut de droit. Toutefois, une fois ouverte, cette porte n’a laissé passer qu’un vent léger : les arguments avancés, selon la Cour, n’étaient pas accompagnés de preuves suffisantes pour ébranler la légitimité du processus.
Cette affirmation mérite attention. En rappelant qu’« aucune anomalie n’était de nature à compromettre la sincérité du scrutin », le premier président de la Cour, Fodé Bangoura, adopte une formule classique mais lourde de conséquences. Elle signifie que la perfection procédurale n’est pas exigée, mais que la sincérité globale du vote demeure le critère ultime. Le juge ne se laisse donc pas enfermer dans un formalisme excessif ; il regarde l’ensemble, jauge la proportion des irrégularités alléguées et tranche selon une logique de préservation de la stabilité institutionnelle.

Certes, cette lecture peut être critiquée. L’opposition espérait sans doute que la Cour se montre plus audacieuse, au risque de froisser les équilibres politiques. Mais en droit constitutionnel comparé, rares sont les juridictions suprêmes qui prennent le risque d’annuler un référendum national, sauf en cas de fraude massive et manifeste. L’arrêt s’inscrit donc dans une jurisprudence prudente, qui privilégie la continuité étatique et l’autorité du suffrage.
La décision elle-même, rédigée sous la forme classique d’un dispositif en quatre articles, a une valeur à la fois juridique et symbolique. Le premier article reconnaît la recevabilité des recours, garantissant la dignité procédurale des requérants. Le deuxième les rejette sur le fond, scellant l’absence de preuves suffisantes. Le troisième proclame les résultats définitifs, acte solennel qui transforme des chiffres en norme juridique. Enfin, le quatrième ordonne notification et publication, marquant le passage du droit prononcé au droit effectif, désormais opposable à tous.
En tant que juriste publiciste, il faut souligner que cette décision ne se réduit pas à une simple validation d’un scrutin. Elle opère une bascule constitutionnelle : le texte soumis au peuple entre désormais en vigueur, doté de la légitimité d’un référendum et de la force contraignante que lui confère la proclamation de la Cour. Le « peuple » s’est exprimé, le juge a scellé ce choix, et l’ordre juridique guinéen s’en trouve transformé.
Une Constitution n’est pas un texte ordinaire. Elle se veut le pacte fondateur, l’expression d’une volonté collective qui transcende les clivages partisans. Or, sa naissance est toujours entourée de contestations, parfois violentes. Ici, la Cour suprême joue son rôle d’arbitre ultime : non pas pour éteindre toute critique ce serait illusoire mais pour donner un point final juridique à un débat politique. À partir de son arrêt, le contentieux électoral est clos ; les opposants peuvent contester dans l’arène politique, mais le droit ne leur offre plus de recours.
Ce moment illustre parfaitement l’ambivalence du droit constitutionnel : entre rigueur normative et réalités politiques, entre la quête de la légitimité et l’impératif de stabilité.
La Guinée franchit une étape, et chacun, opposition, société civile, sympathisants du pouvoir militaire de Mamady Doumbouya, devront désormais composer avec une nouvelle norme suprême.
La proclamation des résultats n’est donc pas seulement une formalité judiciaire. Elle est, pour reprendre les mots d’un grand constitutionnaliste, un « acte d’institution du politique ». Le pays se dote d’un nouveau cadre juridique, et ce cadre n’existe réellement que parce qu’une juridiction « souveraine » en a validé la naissance. En cela, le 26 septembre 2025 restera une date charnière dans l’histoire constitutionnelle guinéenne.
Le processus de légitimation du putschiste du 05 Septembre 2021 est en cours. Bref, il faut reconnaître que la politique s’impose sur le Droit et sur la Justice en République de Guinée.