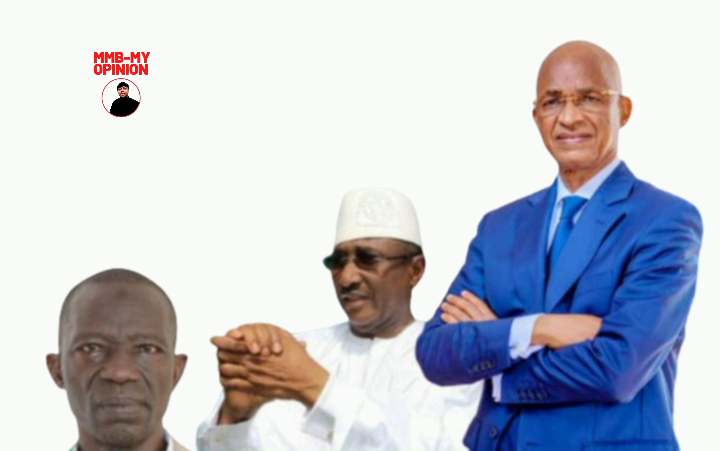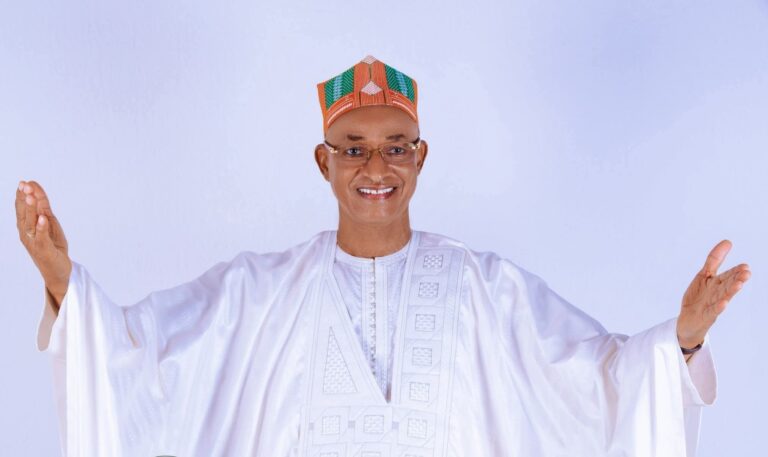Éthiopie : la liberté de la presse sous pression alors que les arrestations de journalistes se multiplient
Depuis plusieurs mois, l’Éthiopie traverse une période sombre pour le journalisme indépendant. Selon un rapport rendu public le 22 septembre par l’ONG Human Rights Watch, une série d’arrestations visant les professionnels des médias témoigne d’une volonté croissante des autorités de restreindre l’espace de la liberté d’expression. Rien qu’en août 2025, six journalistes ont été arrêtés, portant un coup direct à un secteur déjà fragilisé par des années de tensions politiques.
L’organisation de défense des droits humains appelle le gouvernement éthiopien à mettre fin à ces pratiques qualifiées d’arbitraires et à libérer immédiatement toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé leur métier d’informer.
Journalistes réduits au silence
À Addis-Abeba, capitale du pays, les forces de sécurité ont récemment interpellé plusieurs journalistes de la radio privée Sheger FM 102.1. Tigist Zerihun, Mintamir Tsegaw et Eshete Assefa ont été arrêtés le 3 septembre, quelques jours après la diffusion d’un programme traitant de la grève du personnel de santé publique. Malgré le retrait du reportage à la demande de l’Autorité des médias, qui l’accusait de « partialité » et « d’incitation à la violence », les journalistes ont tout de même été placés en détention.
Cette affaire illustre un mécanisme inquiétant : les autorités imposent une censure préalable, puis sanctionnent a posteriori même en cas de conformité. « Certains journalistes disparaissent littéralement, détenus sans que leurs proches sachent où ils se trouvent », dénonce Laetitia Bader, directrice adjointe pour l’Afrique chez Human Rights Watch. Une telle situation équivaut, selon le droit international, à une disparition forcée.
Un climat électoral explosif
La vague d’arrestations s’inscrit dans un contexte politique particulièrement tendu. L’Éthiopie doit organiser ses élections générales en 2026, un rendez-vous crucial pour un pays marqué par des conflits internes et une fragilité institutionnelle persistante. Or, en période préélectorale, la transparence et le pluralisme de l’information devraient être renforcés.
Au contraire, c’est une volonté de contrôle qui s’impose. Les sujets jugés « sensibles » manifestations sociales, mouvements de contestation ou dysfonctionnements des services publics deviennent pratiquement interdits de couverture médiatique. Cette répression laisse planer un doute sérieux sur les conditions dans lesquelles les Éthiopiens pourront exercer leur droit à l’information et, par conséquent, à un vote éclairé.

Une législation taillée pour l’ingérence politique
Le durcissement de la situation ne repose pas seulement sur des pratiques policières. En avril 2025, le Parlement éthiopien a adopté des amendements à la loi sur les médias datant de 2021. Ces révisions renforcent considérablement les pouvoirs de l’exécutif : l’Autorité éthiopienne des médias, jusque-là relativement indépendante, se retrouve désormais sous la tutelle directe de son Directeur général, nommé par le Premier ministre.
Autre recul majeur : la suppression de l’interdiction faite aux membres du Conseil de régulation d’appartenir à un parti politique. Les voix issues de la société civile et des organisations professionnelles de journalistes ont également été exclues du processus. Résultat : un organe qui, au lieu de protéger l’indépendance des médias, devient un instrument politique.
Une menace pour la liberté d’opinion
Ces évolutions législatives et ces arrestations massives ne concernent pas uniquement les journalistes : elles touchent l’ensemble de la société éthiopienne. Lorsque l’accès à une information libre et plurielle est entravé, ce sont les citoyens qui se voient privés de leur droit fondamental à la liberté d’opinion. Dans un pays marqué par une histoire récente de violences interethniques et de tensions politiques, l’étouffement du débat public peut aggraver encore les fractures.
La liberté de la presse est l’un des piliers d’un État démocratique. En la fragilisant, le gouvernement éthiopien prend le risque de miner la confiance des citoyens dans leurs institutions et d’alimenter les frustrations susceptibles de conduire à de nouvelles crises.
L’urgence d’une mobilisation internationale
Human Rights Watch et d’autres organisations de défense des droits humains exhortent la communauté internationale à ne pas détourner le regard. Car au-delà de l’Éthiopie, c’est une question universelle qui se pose : comment garantir le droit d’informer et d’être informé dans un monde où de nombreux régimes cherchent à contrôler le récit national ?
Les autorités éthiopiennes justifient souvent leurs actions par la nécessité de maintenir l’ordre et de lutter contre la désinformation. Mais la frontière entre régulation et répression devient ici de plus en plus mince. Un État qui décide de ce qui peut ou ne peut pas être dit, surtout à l’approche d’élections, ne protège pas sa démocratie : il la met en péril.
Une bataille à mener pour l’avenir
Les arrestations répétées de journalistes en Éthiopie rappellent que la liberté de la presse n’est jamais acquise. Elle doit être défendue, réaffirmée et protégée, surtout dans les moments où elle est la plus menacée. Le droit d’exprimer une opinion, de critiquer, de rapporter des faits ou de questionner les autorités, n’est pas un privilège accordé par l’État mais un droit humain fondamental.
Alors que l’échéance électorale de 2026 approche, l’Éthiopie se trouve à un carrefour décisif : choisir la transparence et le pluralisme, ou s’enfermer dans une spirale autoritaire. Le sort des journalistes emprisonnés en dit long sur la direction prise par les autorités éthiopiennes.