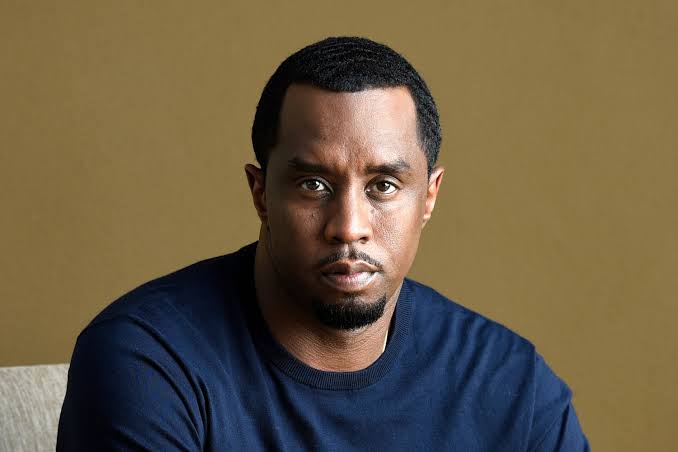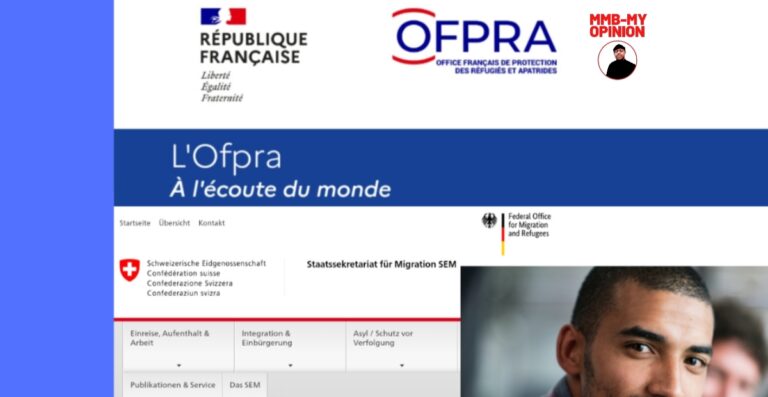Doura Chérif et le procès des gangs de Conakry (1994–1995)
Une affaire-phare pour la justice guinéenne, qui mêla sécurité publique, médiatisation, droits de la défense et mémoire collective.
À la fin 1994 et durant 1995, la Guinée connut un procès exceptionnel par son ampleur et sa médiatisation le procès dit « des gangs » dont la conduite fut associée au nom du magistrat Doura Chérif, alors président de la Cour d’assises de Conakry. Ce procès, qui débuta après une série d’arrestations massives d’adolescents et de jeunes adultes accusés d’avoir semé la terreur dans la capitale, dura plusieurs mois et donna lieu à des peines très lourdes (dont des réclusions à perpétuité et des condamnations décennales). Il demeure, près de trente ans plus tard, un point de référence pour juger la réaction de l’État face au banditisme urbain et pour questionner les garanties procédurales dans un contexte de forte tension.
Qui était Doura Chérif ?
Doura Chérif était un magistrat guinéen réputé pour son expérience et sa fermeté. Il a été présenté par la presse nationale comme le président de la Cour d’assises chargé du fameux procès des gangs, et sa carrière judiciaire (puis d’avocat) l’a rendu très visible dans l’opinion publique guinéenne. Il est décédé le 6 décembre 2020, et à l’annonce de sa mort de nombreux médias ont rappelé son rôle central lors du procès de 1995.
Contexte : émergence d’un phénomène et réponse de l’État
Au début des années 1990, Conakry fit face à une montée de la délinquance juvénile et des bandes armées cambriolages, braquages, agressions qui, selon des enquêtes et analyses parues par la suite, inquiétaient fortement la population et les autorités. Le phénomène fut interprété par les responsables politiques comme un défi à l’autorité de l’État. Dans ce climat, le pouvoir décida d’une réaction visible : arrestations massives, instruction pénale centralisée et organisation d’un procès public et très médiatisé pour frapper les esprits et « restaurer » l’ordre. Les autorités allèrent jusqu’à autoriser la retransmission d’une partie du procès dans les médias nationaux, ce qui fit de l’affaire un véritable événement public.
Chronologie détaillée (1994–1995)
Fin 1994 Arrestations massives : la police procède à l’arrestation d’une cinquantaine de jeunes adolescents ou jeunes adultes soupçonnés d’appartenir à des bandes organisées qui multipliaient braquages et agressions à Conakry. Les dossiers sont transmis à la Cour d’assises.
Décembre 1994 Ouverture du procès : sous la présidence du juge Doura Chérif la procédure s’ouvre à Conakry ; les audiences sont publiques et suivies par la radio-télévision nationale. Le procès va durer plusieurs mois (des sources universitaires et de la FIDH indiquent une durée de l’ordre de 8 mois).
Début 1995 Témoignages spectaculaires : certains prévenus, parmi lesquels Tamba Toundou Feindouno (« Mathias Léno »), sont très médiatisés et leurs auditions produisent un fort retentissement dans l’opinion. Des témoignages d’aveux et des dénonciations croisées marquent les débats.
8 août 1995 Audiences décisives et condamnations : plusieurs peines lourdes sont prononcées : parmi les condamnations rapportées figurent certaines réclusions criminelles à perpétuité (cas de Sékou Tidiane Soumah dit « Chaud-Chaud ») et de longues peines (20 ans, etc.) pour d’autres protagonistes. Des condamnations à mort ont aussi été évoquées dans l’iconographie, mais les comptes rendus publics insistent surtout sur les peines très lourdes et leur portée dissuasive.
Années postérieures : des demandes de clémence, des débats sur la proportionnalité des peines, des appels à la grâce présidentielle et des récits postérieurs (entretiens, articles) prolongent la controverse autour du procès pendant des décennies.
Sources sur la chronologie et la durée : études universitaires et rapport FIDH (compte rendu des audiences et contexte).
Les principaux protagonistes jugés (sélection) et leur sort
Le procès visait plusieurs groupes et individualités, dont certains noms sont restés célèbres dans la mémoire collective guinéenne :
Tamba Toundou Feindouno (« Mathias Léno ») : figure charismatique et très médiatisée. Plusieurs articles postérieurs racontent son rôle central dans la dynamique des aveux et dénonciations.
Sékou Tidiane Soumah (« Chaud-Chaud ») : condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il est resté longtemps symbolique de la sévérité de la sentence prononcée en 1995 et a, à plusieurs reprises, demandé la grâce présidentielle et dénoncé la disproportion de sa peine par rapport à certains coaccusés.
Alpha Kaala Diallo / Indien Kaala : cité comme l’un des condamnés au long terme. Plusieurs récits évoquent son maintien en détention pendant des décennies.
Les comptes rendus d’époque et les analyses postérieures montrent que les peines allaient de longues détentions (20 ans) à la réclusion à perpétuité ; des disparités importantes entre les condamnations ont nourri les suspicions d’arbitraire ou d’inégalité de traitement.
Procédure, garanties et questions de droits de la défense
Plusieurs éléments du dossier provoquent des interrogations récurrentes concernant les garanties procédurales :
Contrainte policière et marque d’interrogatoires : des témoignages et rapports (y compris d’organisations de défense des droits humains) soulignent que certains accusés portaient des traces d’interrogatoires violents au moment où ils comparurent devant la Cour, ce qui pose la question de la libre volonté des déclarations et des aveux. Dans ce contexte, le président de l’audience (Doura Chérif) eut un rôle d’apaisement en rappelant publiquement que les prévenus pouvaient « s’exprimer librement, sans contrainte ». Cette formule, citée dans des analyses, était sans doute destinée à rassurer l’opinion et la communauté internationale, tout en marquant une rupture avec des pratiques policières parfois brutales.
Dénonciations croisées et stratégie de l’accusation : plusieurs articles rapportent que des prévenus, en particulier certains très médiatisés, auraient dénoncé d’autres membres du réseau parfois en échange de promesses implicites de clémence ce qui a rendu les chaînes de preuve difficiles à démêler et a contribué à des condamnations différenciées au sein d’un même groupe.
Médiatisation du procès : l’ouverture des audiences au public et aux médias permit une visibilité inédite pour des procédures pénales de cette ampleur en Guinée. Si cette transparence fut saluée par certains comme une manifestation d’État de droit, elle posa aussi la question de la pression médiatique sur les participants (témoins, accusés, magistrats) et de l’impact de la « scène publique » sur la sérénité des débats judiciaires.
Les organisations de défense des droits (et les spécialistes) ont utilisé l’affaire pour rappeler que la lutte contre la criminalité doit s’accompagner de garanties procédurales solides afin d’éviter des erreurs judiciaires et des sentences disproportionnées.
Controverses et récits postérieurs
Le procès a engendré de multiples controverses et récits contradictoires, qui alimentent encore aujourd’hui débats et articles :
Disparités de peines : la dénonciation la plus répétée est la disproportion de certaines peines (notamment la perpétuité infligée à « Chaud-Chaud ») par rapport à d’autres protagonistes qui, selon les accusés et certains observateurs, auraient commis plus de faits mais obtenu des peines plus légères. Chaud-Chaud a régulièrement évoqué ces inégalités et a raconté des échanges privés avec Doura Chérif, affirmant que le juge lui aurait plus tard reconnu une « erreur ». Ces récits sont repris par la presse guinéenne et par des articles d’opinion.
Rôle de Mathias Léno : le personnage de Mathias a été décrit comme ayant « noyé » beaucoup d’autres prévenus par ses dénonciations ; plusieurs articles et témoignages évoquent la possibilité qu’il ait été instrumentalisé ou qu’il ait coopéré pour obtenir des avantages. Les suites incertaines de son sort ont alimenté rumeurs et enquêtes journalistiques.
Regrets et appels à clémence : à mesure que les années passèrent, des voix (dont parfois celle de Doura Chérif, selon des entretiens) plaidèrent pour la clémence et une relecture des dossiers, en partie pour des motifs humanitaires et familiaux. Ces appels ont suscité des réactions contrastées dans l’opinion.
Lecture critique : entre ordre public et droits fondamentaux
L’affaire des gangs illustre un dilemme classique mais aigu dans les États confrontés à une montée de la violence urbaine : comment concilier la nécessité impérieuse de protéger la population et la volonté de dissuasion, avec l’obligation de respecter les droits procéduraux et d’éviter les erreurs judiciaires ?
Du point de vue de l’État et d’une part importante de l’opinion nationale, le procès de 1995 fut une réponse forte attendue et nécessaire ; la visibilité du jugement servit un objectif politique de réassurance.
Du point de vue des droits humains, les éléments sur la contrainte policière, la médiatisation et les témoignages croisés suscitent des réserves sur la qualité des preuves et la proportionnalité des peines. Le dossier est ainsi devenu un cas d’étude pour spécialistes et organisations sur la dangerosité des «procès spectacles» dans les contextes fragiles.
Héritage de Doura Chérif et mémoire collective
Le nom de Doura Chérif reste étroitement lié à ce procès : pour certains il demeure le magistrat ferme qui a su conduire une procédure difficile et rétablir (ou tenter de rétablir) l’ordre ; pour d’autres il est associé à une justice de rupture qui, en voulant être exemplaire, a laissé des doutes sur l’équité de certaines décisions. Lors de son décès en décembre 2020, beaucoup de médias guinéens ont rappelé publiquement son rôle dans l’affaire des gangs, et des hommages ont été rendus qui montrent combien l’événement demeure présent dans la mémoire judiciaire et populaire.
Le procès des gangs (1994–1995) est un moment-clé de l’histoire pénale récente de la Guinée : il montre la conjonction d’une situation de crise urbaine, d’une réaction politique et judiciaire très visible, et des limites réelles des procédures menées sous forte pression. Doura Chérif, en tant que président de la Cour d’assises, y a joué un rôle central et ambivalent aux yeux des observateurs : garant d’une réponse publique ferme, tout en restant l’objet d’interrogations sur la proportionnalité et l’équité des peines prononcées. Les controverses postérieures (révélations, demandes de grâce, récits des condamnés) montrent que la question principale demeure : la sécurité peut-elle être restaurée sans affaiblir les garanties essentielles qui fondent un État de droit ?