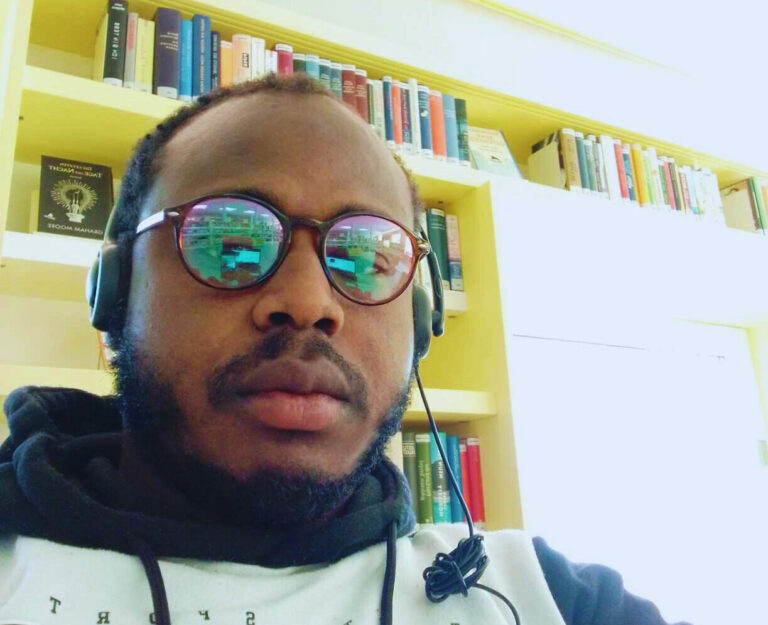Parler politique sans se fâcher: le grand défi des Guinéens
En Guinée, parler politique, c’est un peu comme marcher sur un fil tendu : il faut garder l’équilibre pour ne pas tomber dans la dispute. Que ce soit entre amis, en famille ou sur les réseaux sociaux, le simple fait d’aborder un sujet politique peut très vite transformer une conversation ordinaire en affrontement verbal.
Pourtant, discuter des affaires du pays devrait être un exercice normal, presque citoyen. Pourquoi alors est-ce si compliqué chez nous ?
Héritage d’une histoire politique mouvementée
Notre rapport à la politique n’est pas né d’hier. Il s’est construit sur plusieurs décennies de luttes, d’espoirs et de désillusions. Depuis l’indépendance, la Guinée a connu des périodes d’autoritarisme, des transitions difficiles et des promesses de changement souvent non tenues.
Résultat : la politique est devenue un sujet chargé d’émotions, de blessures et de méfiance. Beaucoup de Guinéens ne voient plus la politique comme un moyen de construire ensemble, mais comme une source de divisions.
Quand le débat devient un combat
Chez nous, la politique dépasse souvent les idées : elle touche à l’identité. On ne parle pas seulement de partis, mais aussi d’origines, de régions ou d’appartenances ethniques. Il suffit de quelques mots pour que les positions se crispent et que la discussion dérape.
Les réseaux sociaux, qui devraient être un espace d’échanges, amplifient ce phénomène. Sur Facebook, WhatsApp ou X (Twitter), chacun défend son “camp” avec passion, parfois avec colère, injure et menace. La nuance disparaît, la tolérance aussi. C’est dommage, car la diversité d’opinions est une richesse, pas une menace.
Apprendre à écouter avant de répondre
Je crois que le vrai problème n’est pas qu’on parle trop de politique, mais qu’on écoute trop peu. On veut convaincre avant même de comprendre ce que l’autre pense. Pourtant, écouter ne veut pas dire être d’accord. C’est simplement reconnaître que la Guinée appartient à tous, et que chaque voix compte.
Discuter sans se fâcher, c’est accepter que deux idées politiques contradictoires peuvent coexister. C’est aussi comprendre que les désaccords ne sont pas forcément des divisions.
Des signes d’espoir
Heureusement, les choses bougent. Partout dans le pays, des jeunes essaient de redonner un sens au débat public. Des associations, des influenceurs, bloggueurs organisent des discussions, souvent dans le calme et le respect.
On y voit des jeunes de différentes régions échanger des idées, rire ensemble, débattre sans s’insulter.
Ces initiatives montrent qu’une autre manière de parler politique est possible : plus ouverte, plus lucide, plus fraternelle.
Changer notre culture du débat
Je pense que le changement doit commencer dès l’école. Apprendre aux enfants à exprimer une opinion, à débattre sans crier, à argumenter avec respect, c’est semer les graines d’une nouvelle culture politique.
Les médias aussi ont un rôle important à jouer : donner la parole à tous, vérifier les faits, éviter les discours qui attisent la haine.
Et puis, il y a nous, simples citoyens. Chacun peut choisir de ne pas répondre à la provocation, de calmer le ton, d’encourager le dialogue plutôt que le clash. Ce n’est pas de la faiblesse, c’est de la maturité.
La politique, un lien avant tout
Parler politique ne devrait pas nous diviser, mais nous rapprocher. C’est en débattant qu’on comprend mieux le pays, qu’on découvre d’autres réalités, d’autres espoirs. La Guinée a besoin de discussions franches, mais aussi apaisées.
La prochaine fois qu’une conversation politique s’enflamme, rappelons-nous ceci :
Parler politique, c’est aimer son pays.
Se fâcher, c’est l’oublier.
Et si nous faisions le pari de la parole qui construit, plutôt que celle qui blesse ?