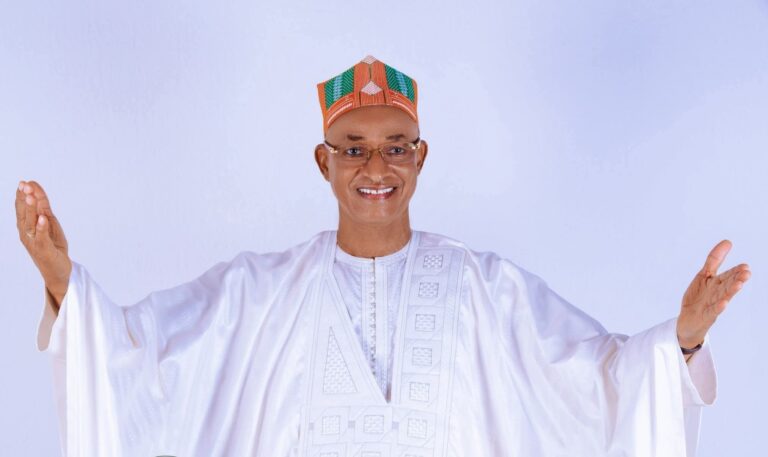Madagascar : quand l’armée choisit le peuple, analyse d’une crise en mutation
Le 11 octobre 2025 restera dans l’histoire de Madagascar. Une partie de l’armée, notamment le CAPSAT, a décidé de se rallier aux manifestants. Ce geste inédit bouleverse les équilibres politiques et révèle une fracture profonde entre le pouvoir et la société. Analyse d’un tournant décisif.
Un pays au bord de l’explosion sociale
Depuis plusieurs semaines, Madagascar vit au rythme des manifestations. À l’origine, il ne s’agissait que d’une série de protestations contre les coupures d’eau et d’électricité.
Mais très vite, la colère s’est muée en révolte politique. Dans les rues d’Antananarivo, les jeunes scandent désormais des slogans appelant à la démission du président Andry Rajoelina et à la mise en place d’une gouvernance plus juste et transparente.

Les coupures de courant ne sont que la partie visible d’un mal plus profond : inflation, chômage, corruption et inégalités sociales ont fragilisé un pays déjà éprouvé.
Le pouvoir, accusé d’immobilisme, a répondu par la force, une stratégie qui a fini par se retourner contre lui.
Le CAPSAT, symbole d’une rupture militaire
Le CAPSAT, unité technique de l’armée malgache, est au cœur du séisme.
Ses officiers ont publiquement annoncé leur refus d’obéir à des ordres jugés illégitimes et ont appelé à ne plus tirer sur les citoyens. Certains ont même escorté les manifestants jusqu’à la place du 13 Mai, lieu hautement symbolique des luttes populaires.

Ce geste, à première vue isolé, a un poids historique. Le CAPSAT avait déjà joué un rôle déterminant en 2009 lors de la chute du président Marc Ravalomanana. Son retour sur la scène politique en 2025 rappelle combien l’armée reste un acteur clé du pouvoir malgache.
Un pouvoir fragilisé et un État sous pression
Le président Rajoelina, autrefois maître du jeu, voit son autorité s’effriter.
Les appels au dialogue du Premier ministre Ruphin Fortunat Zafisambo n’ont pas suffi à calmer la colère populaire.
Au contraire, les images d’une armée fraternisant avec la foule ont nourri le sentiment que le régime a perdu le contrôle.
Les réseaux sociaux s’enflamment, les rumeurs se multiplient certains affirment que le président aurait quitté la capitale.
Le pouvoir tente de maintenir une façade d’unité, mais la réalité est plus complexe : la chaîne de commandement militaire semble fissurée.
Le risque d’une armée divisée
Le danger le plus immédiat est celui d’une fragmentation des forces de sécurité.
Si certaines unités restent loyales au pouvoir, d’autres pourraient suivre le CAPSAT.
Cette division interne menace l’équilibre du pays : un affrontement entre militaires, policiers et gendarmes serait catastrophique.

Pour l’instant, les officiers du CAPSAT affirment ne pas vouloir de coup d’État. Ils se présentent comme “les protecteurs du peuple”, prônant une transition pacifique.
Mais l’histoire de Madagascar nous enseigne que de tels équilibres sont précaires : un incident, une provocation, et tout peut basculer.
Une transition incertaine, mais pleine d’espoir
Deux scénarios se dessinent :
Une transition négociée, sous l’égide de l’armée et de la société civile, vers des élections libres et une refondation institutionnelle ;
Ou une dérive violente, où chaque camp tente d’imposer sa légitimité, risquant d’entraîner le pays dans un nouveau cycle d’instabilité. La population reste partagée entre espoir et méfiance. Beaucoup voient dans le ralliement du CAPSAT un signe d’unité nationale retrouvée ; d’autres redoutent que les ambitions militaires prennent le pas sur la voix démocratique.
Une leçon d’histoire et de responsabilité
Le ralliement du CAPSAT n’est pas qu’un geste de désobéissance : c’est un signal politique fort.
Il traduit la perte de confiance entre le pouvoir et ceux qui sont censés le défendre.
Quand l’armée se range du côté du peuple, c’est souvent que le contrat social a été rompu.
Pour sortir de la crise, Madagascar doit retrouver le sens du dialogue, du respect des institutions et de la justice sociale.
Les dirigeants ne peuvent plus ignorer les signaux d’alerte.
L’avenir du pays dépendra de leur capacité à écouter, négocier et reconstruire une légitimité perdue.
En observant cette crise, on ne peut s’empêcher de voir à quel point Madagascar reste prisonnier de ses cycles politiques : alternance entre espoir et déception, démocratie et pouvoir personnel, réforme et répression.
Mais cette fois, quelque chose semble différent.
L’armée, souvent instrument du pouvoir, se pose comme rempart moral face à la dérive autoritaire.
Si cette position se confirme, elle pourrait ouvrir la voie à une transition inédite celle d’un pays où les armes cessent enfin de parler, pour laisser la place aux voix du peuple.