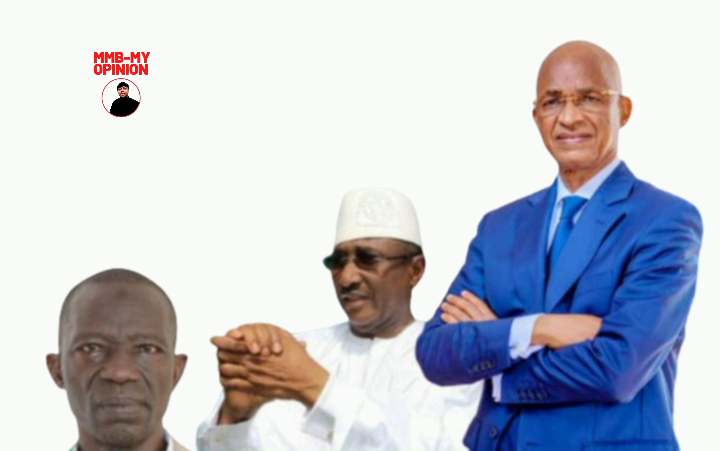Comment les Guinéens s’adaptent à la vie chère : Inflation en Guinée
Depuis plus d’un an, la Guinée fait face à une inflation persistante qui pèse lourdement sur le quotidien. Les prix des produits de base ne cessent de grimper, les revenus stagnent, et le coût du transport ou du logement devient insoutenable pour une grande partie de la population.
Des marchés de Conakry aux zones rurales, l’inflation s’est installée dans les conversations, dans les calculs des ménagères et dans les poches des travailleurs.
Une flambée des prix qui asphyxie les foyers
La Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) estime le taux d’inflation à plus de 8 % en 2023, qu’en est-elle en 2025? Sur le terrain, les Guinéens parlent d’une hausse bien supérieure.
Le prix du riz importé, du sucre et de l’huile végétale a doublé en deux ans. Le carburant, passé à plus de 12 000 francs guinéens le litre, entraîne une hausse générale du coût du transport et des marchandises.
Cette situation s’explique par plusieurs facteurs :
la dépendance du pays aux importations alimentaires ;
la dépréciation du franc guinéen face au dollar ;
la hausse du coût du fret maritime et de l’énergie ;
et, plus largement, la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales depuis la pandémie.
Pour de nombreux ménages, le calcul est simple : les revenus restent les mêmes, mais tout coûte plus cher. Résultat : on achète moins, on mange différemment, on reporte certains projets.
« Avant, je pouvais remplir mon panier pour la semaine avec 300 000 francs. Aujourd’hui, c’est à peine deux jours de repas », explique une vendeuse de condiments à Madina.
La débrouille comme système de survie
Face à la flambée des prix, la débrouille devient une véritable stratégie de vie. Dans les quartiers populaires, la solidarité s’organise à petite échelle. Les tontines (épargnes communautaires) se multiplient, permettant aux familles de se soutenir mutuellement.
Certains choisissent de revenir vers la campagne pour cultiver un petit lopin de terre et réduire leurs dépenses alimentaires. D’autres misent sur la vente de produits faits maison : jus naturels, beignets, savon, vêtements d’occasion.
Les jeunes, eux, multiplient les petits métiers. Le Taxi-Moto, la vente en ligne ou les services de proximité deviennent des moyens de survie.
« Avant, je travaillais comme agent de sécurité. Aujourd’hui, je fais le Taxi-Moto et je gagne un peu plus. Il faut s’adapter sinon tu ne t’en sors pas », raconte un Motard, à Dixinn.
Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans cette nouvelle économie informelle : Facebook, WhatsApp et TikTok sont devenus des marchés virtuels où l’on vend, négocie et troque presque tout.
Les efforts du gouvernement : des mesures limitées
Conscient de la pression populaire, le gouvernement a tenté d’agir. Plusieurs mesures ont été annoncées pour stabiliser les prix du riz, du carburant et de la farine. Des contrôles ont également été menés sur certains marchés pour lutter contre la spéculation abusive.
Mais dans la réalité, ces initiatives se heurtent à des difficultés structurelles : une économie largement informelle ; une faible capacité de régulation ; et un manque d’infrastructures pour soutenir la production locale.
De plus, les subventions pèsent lourdement sur le budget de l’État. Les marges de manœuvre financières restent limitées dans un contexte où la majorité des recettes publiques provient du secteur minier.
Le défi est donc de taille : répondre à l’urgence sociale sans déséquilibrer davantage les finances publiques.
Plusieurs économistes estiment que la solution ne réside pas dans les aides temporaires, mais dans une transformation structurelle du modèle économique.
« La Guinée doit investir massivement dans la production locale, notamment agricole. Tant qu’on importera l’essentiel de ce qu’on consomme, l’inflation reviendra sans cesse », souligne un économiste de Conakry interrogé par moi-même.
Produire local pour reprendre le contrôle
La crise actuelle rappelle une évidence : un pays riche en terres arables ne devrait pas dépendre autant des importations alimentaires.
Dans plusieurs régions, des coopératives agricoles se structurent pour relancer la culture du riz local, du maïs et du manioc. Ces initiatives, souvent portées par des jeunes ou des ONG locales, visent à créer des circuits courts et à valoriser les produits du terroir.
Des entrepreneurs guinéens investissent également dans la transformation agroalimentaire : jus naturels, farine locale, huile de palme, confitures artisanales. Même si ces projets restent modestes, ils contribuent à réduire la dépendance aux produits importés.
L’objectif est double : créer des emplois locaux et stabiliser les prix en réduisant les coûts de transport et d’importation.
L’économie informelle : moteur silencieux de la résilience
En Guinée, près de 80 % des actifs travaillent dans l’informel. Ce secteur, souvent ignoré des statistiques officielles, joue pourtant un rôle vital dans la survie économique du pays.
Marchandes de légumes, tailleurs, coiffeuses, mécaniciens ou mototaxis : tous participent à maintenir la circulation de l’argent et à répondre aux besoins quotidiens de la population.
Cette économie de la débrouille a ses limites manque de protection sociale, précarité, absence de fiscalisation mais elle reste le principal filet de sécurité des Guinéens.
Dans un contexte d’inflation, elle démontre la capacité d’adaptation d’un peuple habitué à faire beaucoup avec peu.
Une crise révélatrice mais porteuse d’espoir
L’inflation agit comme un miroir grossissant : elle met en lumière les failles d’un système économique trop dépendant des matières premières, mais aussi la créativité des citoyens.
Elle rappelle que la véritable richesse d’un pays ne se mesure pas seulement à ses ressources minières, mais à la capacité de son peuple à créer, produire et s’entraider.
La Guinée possède des atouts considérables : jeunesse dynamique, terres fertiles, ressources naturelles abondantes. Si ces forces sont mieux exploitées, la crise actuelle pourrait devenir un levier de transformation.
Une résilience qui inspire
Malgré la dureté du quotidien, les Guinéens gardent le sourire, l’énergie et l’envie de s’en sortir.
L’inflation n’est pas seulement une épreuve économique, c’est aussi une leçon de solidarité. Dans chaque quartier, dans chaque marché, on retrouve cette même volonté : ne pas subir, mais s’adapter.
Peut-être que dans cette résistance silencieuse se trouve le vrai moteur du changement. Car à travers les gestes simples produire localement, partager, innover la Guinée esquisse peu à peu un avenir où la dignité l’emporte sur la précarité.