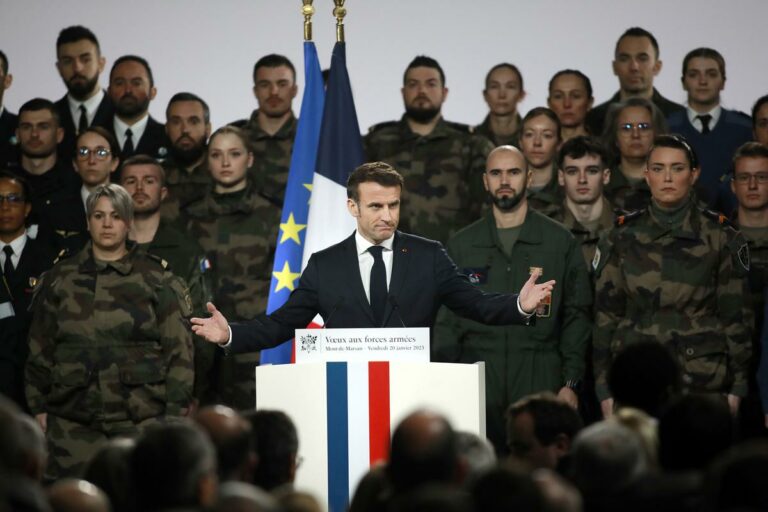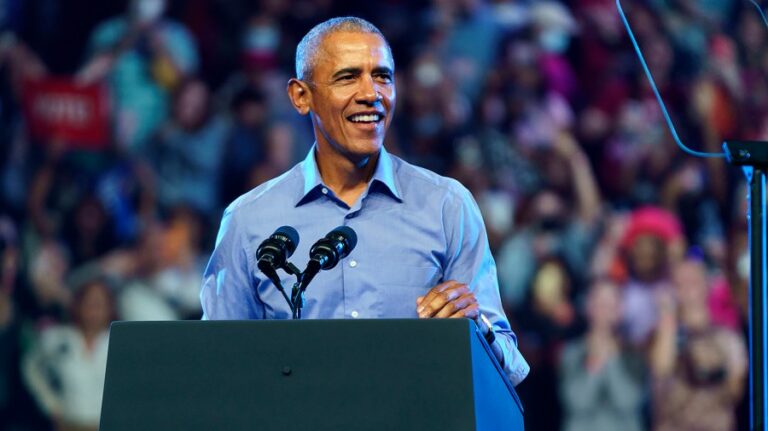Rio de Janeiro : Une centaine de morts dans une opération policière, le Brésil face à son plus grand massacre urbain
Dans les favelas de Rio, les tirs ont résonné toute la journée de mardi.
Ce qui devait être une opération ciblée contre le crime organisé s’est transformé en bain de sang : au moins 119 morts, dont plusieurs civils.
Une tragédie qui ravive le débat sur la violence policière et la guerre ouverte entre l’État brésilien et les quartiers populaires.
Un assaut sans précédent
Mardi à l’aube, des milliers de policiers ont investi les favelas du Complexo do Alemão, de Penha et de Maré, zones longtemps considérées comme des bastions du trafic de drogue.
L’objectif affiché : frapper le Comando Vermelho, puissant réseau criminel armé.
Blindés dans les rues, hélicoptères dans le ciel, drones en soutien… L’État a déployé un véritable arsenal militaire.
Mais les heures qui ont suivi ont laissé une empreinte indélébile : 119 morts, selon le dernier bilan officiel.
Parmi eux, quatre policiers et des dizaines d’habitants pris dans les échanges de tirs.
« C’était une scène de guerre », raconte un résident de Penha. « Ils entraient dans les maisons, tiraient à travers les murs. »

Des victimes et des questions
Alors que les autorités présentent cette opération comme un « succès contre le narcoterrorisme », des associations locales parlent plutôt de massacre.
Des témoins évoquent des exécutions sommaires, des tirs dans le dos, des corps abandonnés sur la voie publique.
Les ONG Redes da Maré et Amnesty International Brésil réclament une enquête indépendante sur les conditions de la tuerie.
Plusieurs familles cherchent encore à identifier leurs proches disparus.
« Ce n’était pas une opération, c’était une punition collective », accuse une militante communautaire.
La violence comme politique d’État
Depuis des années, Rio de Janeiro vit dans un équilibre précaire entre crime organisé et répression policière.
Les favelas, souvent laissées à elles-mêmes, cumulent pauvreté, chômage et absence de services publics.
Dans ce contexte, la stratégie du « tout sécuritaire » apparaît chaque fois plus inefficace.
En 2024 déjà, plus de 1 300 personnes avaient été tuées par les forces de l’ordre dans l’État de Rio.
La plupart des victimes provenaient des quartiers les plus défavorisés.
« On ne combat pas la criminalité en tuant les pauvres », résume une chercheuse en sécurité publique de l’institut Sou da Paz.

Un choc politique
Face à l’ampleur du drame, le gouvernement fédéral a demandé des comptes au gouverneur Cláudio Castro, qui continue de défendre l’opération.
Des députés de gauche ont réclamé la création d’une commission d’enquête parlementaire.
Sur les réseaux sociaux, le mot-clé #ChacinaDoRio (« Massacre de Rio ») s’est propagé comme une traînée de poudre.
À l’international, les réactions se multiplient. Plusieurs ONG dénoncent un usage « disproportionné et arbitraire » de la force, appelant le Brésil à rendre des comptes devant la justice.
Entre peur et lassitude
Sur le terrain, les habitants tentent de survivre au lendemain du chaos. Les écoles ont fermé, les transports ont été suspendus, et beaucoup n’osent plus sortir.
Dans les ruelles du Complexo do Alemão, on allume des bougies et on inscrit sur les murs des noms de victimes.
« On veut juste vivre. Ni les trafiquants ni la police ne nous protègent », souffle une mère de famille, devant une maison criblée de balles.
Un pays face à lui-même
Ce raid restera comme un tournant dans l’histoire de Rio.
Il met en lumière les fractures d’un pays où la sécurité publique repose encore sur la peur, la punition et la militarisation des pauvres.
Tant que ces quartiers resteront abandonnés, chaque nouvelle opération ne fera qu’ajouter une ligne à la longue liste des morts anonymes de la favela.